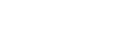Laurent nous présente Michel Foucault
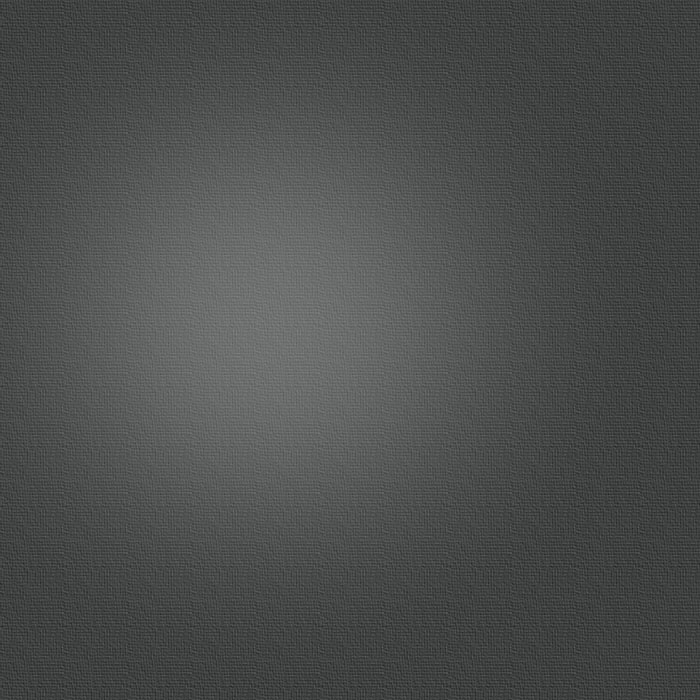
Michel foucault, philosophe de la médecine
mercredi 21 mai 2008

Il est temps que je m’explique sur ma foucalmania !!! La première raison de ma ferveur est toute simple, c’est que le champ de la médecine est sans doute l’un de ceux que la pensée du philosophe a le plus investi.
Et ceci n’est pas étonnant quand on connaît la vie de Foucault. Il suffit d’ouvrir sa biographie pour constater à quel point sa vie est sous le signe de la médecine.
Dans la famille Foucault, on est chirurgien de père en fils. Le père de Michel est chirurgien à Poitiers et professeur d’anatomie à l’Ecole de médecine. Il est lui-même fils de chirurgien, et a épousé Anne Malapert, fille de chirurgien, également professeur à l’Ecole de médecine. Ce père ne conçoit pas d’autre avenir pour son fils que la carrière médicale. Mais Michel passionné d’histoire et de philosophie en a décidé autrement, il éprouve une véritable aversion pour les études de médecine. Entre Michel et son père les relations sont conflictuelles.
Dès l’automne 1945, à 19 ans Michel quitte Poitiers et arrive à Paris pour préparer le concours d’entée de la rue d’Ulm. Ainsi est consommée la rupture physique avec ce père que Michel n’aime guère et que ses biographes décrivent comme très peu présent à la famille. Mais l’image du père chirurgien reste présente. Ainsi quand Foucault dans un entretien, accordé à la suite de la parution de son œuvre la plus célèbre « les Mots et les choses », analyse son style il use de la métaphore chirurgicale : « peut-être, je trace sur la blancheur du papier ces mêmes signes agressifs que mon père traçait jadis sur le corps des autres quand il opérait. J’ai transformé le bistouri en porte plume ».
L’attirance profonde de Michèle Foucault pour la psychologie lui donne l’occasion de pénétrer dans l’univers de l’hôpital psychiatrique. Dès qu’il obtient sa licence de philosophie à la Sorbonne en 1948, il s’inscrit en licence de psychologie. C’est à cette époque de sa vie la voie qu’il a choisie. Il se repose alors la question de faire ses études de médecine. Ce n’est plus la parole du père qui l’interpelle mais le problème qui agitait à l’époque bien des philosophes qui s’intéressaient à la psychiatrie : faut-il être médecin pour se spécialiser en psychologie ?
Sur les conseils de Lagache, grand nom de la science psychologique de l’après guerre, Michel Foucault renonce définitivement aux études de médecine. Il n’interrompt pas sa formation scientifique pour autant et il obtient en 1952, après avoir passé l’agrégation de philosophie, le diplôme de psychologie pathologique. Ces études lui ouvrent les portes de l’hôpital Saint Anne où Foucault travaille comme psychologue. Il fait alors un stage dans le laboratoire d’électrophysiologie du Docteur Delay où Laborit expérimente le premier neuroleptique. Dans les années de jeunesse Foucault reste très proche de l’univers médical, c’est à partir de cette expérience qu’il prend son envol pour devenir le philosophe dont la pensée marque une rupture majeure avec toute une tradition philosophique. Après l’énorme succès qui suit la publication « des Mots et des choses », Foucault devient la figure emblématique de l’intelligentsia française à la hauteur de Jean Paul Sartre. Il rencontre finalement l’impuissance de la médecine quand il est emporté à l’âge de 58 ans par le SIDA à une époque où cette maladie, mal identifiée, commençait ses ravages et où les traitements actuels n’existaient pas.
Une pensée qui se découvre et met à l’épreuve ses fondements à partir du domaine de la médecine, c’est ainsi qu’on peut situer « Naissance de la clinique » qui précède l’œuvre majeure les Mots et les choses. Foucault a été fasciné par les trente dernières années du XVIII e siècle, et les progrès prodigieux de la rationalité médicale dans ce temps très court. Certes par la suite le champ de réflexion de Michel Foucault déborde largement le domaine médical et se portera sur la pénalité, la sexualité et dans les dernières œuvres, Foucault qui avait annoncé la mort de l’homme dans Les mots et les choses, revient à l’éthique du sujet.
Une vie, une œuvre sous le signe de la médecine. Mais cela ne suffit pas à expliquer ma ferveur pour M Foucault. Il y a surtout ce curieux sentiment que j’exprimerai d’abord de la manière la plus spontanée : pourquoi Foucault donne-t-il tant envie de dire Foucault ? Pourquoi sa lecture est-elle une expérience presque contraignante au partage ? Sans doute parce que la préoccupation centrale de Foucault est de produire les conditions d’une vie philosophique, pour soi et pour les autres.
La pensée de Foucault n’est jamais pure pensée, elle participe toujours selon ses dires mêmes, d’une expérience personnelle : « il n’y a pas de livre que j’ai écrit sans au moins en partie, une expérience directe, personnelle ». Et de son passage à l‘hôpital Saint Anne, il dira dans une interview en 1982 « Il n’y avait pas de statut clair pour un psychologue dans un hôpital psychiatrique. Aussi comme étudiant en psychologie, j’avais là un statut très étrange. Le chef de service était très gentil avec moi et me laissait faire ce que je voulais [...]. J’occupais un poste intermédiaire entre les malades et les médecins, et ce n’était pas du fait d’un mérite particulier où à cause d’une attitude spéciale, c’était la conséquence de cette ambiguïté de mon statut qui me forçait à garder une distance envers les médecins. Je sais que cela ne tenait pas à un mérite personnel parce que, à ce moment là, je ressentais tout cela comme une sorte de malaise ; c’est seulement quelques années après quand j’ai commencé à écrire ce livre sur l’histoire de la psychiatrie que ce malaise, cette expérience personnelle, a pris pour moi la forme d’une critique historique ou d’une analyse structurale. ». Toute sa vie Foucault a surmonté ses difficultés au prix d’un travail philosophique pour lui- même et pour les autres. Pour les autres..., il le dit de façon imagée dans un interview : « Tous mes livres [...] sont, si vous voulez, des petites boites à outil. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, de telle idée, telle analyse comme d’un tournevis ou d’un desserre boulon, pour court-circuiter, disqualifier les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux là même dont mes livres sont issus...eh bien c’est tant mieux. ». Dans un autre interview, Foucault parle de son œuvre d’une façon plus subversive : « Je suis un artificier, dit-il, je fabrique quelque chose qui sert finalement à un siège, à une guerre, à une destruction. Je ne suis pas pour la destruction, mais je suis pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire tomber les murs. Un artificier, c'est d'abord un géologue. Il regarde les couches de terrain, les plis, les failles. Qu'est-ce qui est facile à creuser ? Qu'est-ce qui va résister ? Il observe comment les forteresses sont implantées. Il scrute les reliefs qu'on peut utiliser pour se cacher ou pour lancer un assaut. Une fois tout cela bien repéré, il reste l'expérimental, le tâtonnement. On envoie des reconnaissances, on poste des guetteurs, on se fait faire des rapports. On définit ensuite la tactique qu'on va employer. Est-ce la sape ? Le siège ? Est-ce le trou de mine, ou bien l'assaut direct ? La méthode, finalement, n'est rien d'autre que cette stratégie. »
En quoi consistent ces fameux outils Foucault ? Tâchons d’esquisser les grandes lignes de sa philosophie. Rompant avec toute un courant philosophique dans la tradition de Descartes et son cogito ou de Hegel, qui a voulu construire un système indépassable, Foucault a renoncé à chercher ce point de départ absolu de la pensée à partir duquel on pourrait édifier un système définitif et universel, ce qui l’intéresse de saisir la pensée dans son histoire ; l’histoire des systèmes de pensée est de fait l’intitulé de son cours au collège de France. Foucault n’a pas développé une philosophie sollipsique, il s’est tourné vers le travail d’archives dès le début de sa carrière de philosophe. Il dit lui-même : « au lieu de faire l’introspection, l’analyse de moi-même, l’analyse de mon expérience vécue, je me suis jeté à corps perdu dans la poussière de l’archive. » Foucault procède à des biopsies, il prélève des fragments dans les archives comme dans les tissus. A travers ce travail d’archive, il met dans la perspective de l’histoire les données du monde actuel dans des domaines aussi variés que la folie, la répression ou la sexualité. Mais il ne s’agit pas d’histoire dans le sens où nous l’entendons habituellement, il s’agit d’une démarche archéologique. Cette démarche archéologique consiste à repérer à travers la couche superficielle actuelle de l’objet étudié, les différentes strates qui constituent son soubassement.
Ce qui intéresse Foucault, c’est d’individualiser ces strates, de repérer en chacune d’elles ce qui les structure, leur isomorphisme. Ces structures de pensée, il les cherche en amont des connaissances, au niveau de cet a priori qui rend la connaissance possible ou qui, au contraire, d’entrée de jeu la met hors de portée. Foucault se donne pour tâche d’identifier les règles de partage entre ce qui est considéré comme vrai ou faux, licite ou illicite, normale ou anormale à une époque donnée et de démonter les systèmes de pouvoir qui déterminent ce partage. C’est cette dimension du pouvoir qui introduit la nuance entre le terme archéologie et généalogie.
Ainsi, l’analyse d’un objet, prenons par exemple l’hôpital, ne sera pas verticale considérant sa forme actuelle comme la référence à laquelle les formes antérieures seraient comparées comme si elles avaient toujours visé le modèle que nous connaissons. Il s’agit de renoncer au point de vue téléologique. La démarche archéologique prétend au contraire à une analyse horizontale, elle cherche dans quelle structure de pensée et dans quel jeu de pouvoir, l’hôpital se trouve pris à une époque donnée et cette analyse se fait en continuité avec d’autres systèmes, le régime politique, la structure de la société, les courants littéraires et philosophiques. Pour Foucault, il n’y pas d’invariant universel, l’homme tout au long de son histoire est façonné dans son rapport à lui-même, à la sexualité, à la vérité par des systèmes de pouvoir. Aujourd’hui c’est la biopolitque qui a pris le pouvoir c’est à dire l’ordre de la médecine, notre société ne s’articule plus avec le droit mais avec la norme. Et il n’est pas indifférent, je crois, qu’un étudiant en master de philosophie pratique et médicale en ait pleinement conscience.
La lecture de Foucault nous amène à faire cette expérience si particulière, comme une transformation du regard, une sorte d’effet zoom arrière, ouvrant un espace où il devient possible de penser autrement.
On ne peut quitter Foucault sans évoquer son humanité, son personnage qui reste toujours à la limite de l’ombre et la lumière. La dynamique de pensée de Foucault est étrangement liée à son homosexualité ; il vit mal cette homosexualité dans ses années de jeunesse, il fait une tentative de suicide, plus tard il l’affirme comme une volonté d’être. Foucault cherchera tout au long de son oeuvre à mettre dans la lumière de sa pensée, les hommes de l’ombre, les prisonniers, les fous, les hommes infâmes, ambiguës, ainsi le personnage d’Herculine Babin hermaphrodite. Il s’intéresse à des auteurs qui sont aux confins de la folie ou de la morale, comme Georges Roussel, Antonin Artaud, Georges Bataille, Sade, Hölderlein.
Je pense que le meilleur moyen pour aborder Foucault est de commencer par lire ses conférences au Collège de France qui ont été publiées chez Gallimard et dont le dernier recueil vient de sortir. La forme est celle de l’exposé, de la conférence, donc très accessible, très lisible. Je suggère l’ordre suivant : « Les Anormaux », « Le Pouvoir Psychiatrique », « Sécurité territoire et population », « L’herméneutique du sujet ».
Bonne lecture, et bien venu au fan club Foucault !!
Laurent Vercoustre
Michel Foucault (1926-1984)